Schengen : libre circulation pour les citoyens ou les ressources humaines ?
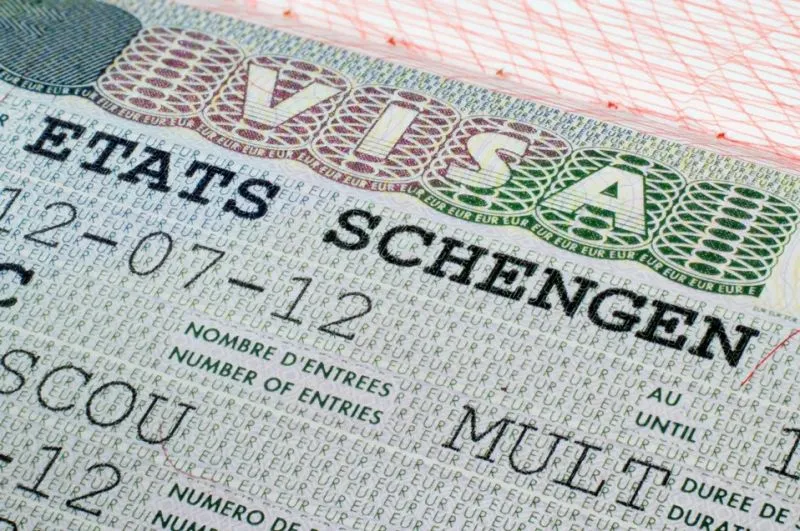
Blog post sur LinkedIn, 14/06/2025, de Sven Franck (in Deutsch, in english)
TL;DR – C'est l'anniversaire de Schengen ! 🎂 Le 14 juin 1985, l'accord visant à abolir les contrôles aux frontières a été signé à Schengen. 40 ans plus tard, 29 pays y participent : l'UE moins Chypre et l'Irlande, mais avec la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Pourtant, tout ne va pas pour le mieux au zone de Schengen.
La Roumanie et la Bulgarie n'ont été admises qu'à contrecœur en 2024, après avoir rempli les critères formels depuis 2011, à cause du veto solitaire de l'Autriche (voir le comportement électoral de la diaspora roumaine à travers de l'Europe) et avec le retour régulier des contrôles aux frontières pour plaire à l'électorat d'extrême droite respectif. Nous sommes ainsi dans la situation actuelle et conflictuelle de Schengen et de la libre circulation.
Mouvement perpétuel ?
La libre circulation dans l'UE existe sous quatre formes : pour les capitaux, les biens, les services et les « personnes » conformément à la directive 2004/38/CE. Le terme « personnes » semble être un maquillage appliqué à « main-d'œuvre », et le diable se cache dans les détails : je m'installe actuellement en Slovénie et j'ai été surpris d'apprendre que tant que je continue à me déplacer, tout va bien. Mais dès que j'arrête de bouger, je dois demander un titre de séjour. Ah ? J'ai toujours trouvé étrange que les autorités françaises exigent une facture d'électricité pour prouver la résidence ; en Slovénie, hélas, mon droit de séjour en tant que « travailleur » était soumis à conditions et pouvait être refusé.
Six mois plus tard, j'ai obtenu un permis de séjour 🛂 – non sans qu'on m'ait précisé qu'après 90 jours, j'étais resté illégalement dans le pays. Schengen vous fait franchir les frontières, mais après... les choses deviennent intéressantes.
Et les citoyens ?
Il est évident pourquoi la directive sur la libre circulation parle de « personnes » plutôt que de « main-d'œuvre ». Il est aussi évident pourquoi elle ne parle pas de « citoyens ». Les citoyens ont des droits, et actuellement beaucoup de ces droits restent bloqués à la frontière de votre pays d'origine, chacun accompagné de sa boîte de Pandore de formalités transfrontalières. Comparez avec les États-Unis, où vous pouvez passer d'un État à l'autre avec tous vos droits, grâce à la Constitution : « Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les différents États. »
L'Europe est loin d'avoir une Constitution ou une Union fédérale, mais je pense qu'il est temps de simplifier les choses. Une « Europe plus forte » ne devrait pas se mesurer au nombre d'armes achetées par chaque État membre, mais aussi au degré d'intégration. Et tout comme les contrôles aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen ne rendront pas l'Europe plus forte, lier le plein droit de vote à la nationalité plutôt qu'à la citoyenneté et à la résidence alimente également les nationalismes.
Réfléchissez : la Slovénie se classe 62e sur 67 pour attirer les travailleurs hautement qualifiés. La Nouvelle-Zélande accorde le droit de vote complet après 24 mois de résidence continue. Les meilleurs talents européens sont souvent aussi les plus mobiles. Pourquoi ne pas combiner les trois pour voir à quel point un État membre peut devenir attractif en considérant les talents non pas comme des « travailleurs » ou des « personnes », mais comme... des « citoyens ». Parlons plus sur #jumpstartEU.